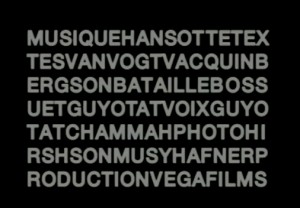by : Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville
durée : 15:44 mn
2000
et voici le générique « original » de la fin du film de JLG
D’emblée, on est époustouflé par tant de beauté : un paysage, un arbre, des promeneurs, une aria et une jeune fille à bicyclette. Peu après, un bus traverse la nuit en silence, comme dans un flottement ; on imagine un transport de prisonniers pendant la guerre en Yougoslavie – trace mystérieuse qui se perd dans l’obscurité. Il s’agit ici de l’origine du XXIe siècle, une œuvre de commande réalisée en 2000 pour l’ouverture du Festival de Cannes – une tentative, comme il dit. « J’ai essayé de couvrir le souvenir des terribles explosions et crimes en tout genre des hommes par le visage des enfants et les larmes et les sourires des femmes. » Bien sûr, la tentative devait échouer, car dans cette rétrospective, il n’y a aucun remède contre les horreurs du siècle écoulé. Godard passe le XXe siècle en revue, dans le sens inverse ; ses courants majeurs sont constitués d’armées et de réfugiés, de canonnades et de prisonniers, de trains de marchandises et de montagnes de cadavres, de conquêtes et d’occupations, d’avilissement et de torture. Et quand une scène part à la recherche d’un siècle perdu, il ne s’agit pas de retrouver la douceur du souvenir mais une époque qui est perdue parce que ravagée par la violence et les guerres. L’autre scène, « Les plus belles années de notre vie » (d’après le film de William Wyler, The best years of our lives), n’est plus qu’humour macabre.
Le XXe siècle, « pour moi » – rajoute-t-il en guise d’excuse –, est ornement et masse ; ce sont des destins isolés, noyés dans les grands courants, à moins qu’ils ne trouvent leur territoire dans une quelconque histoire qui est à la fois protection et consolation : « Il faut bien que tu comprennes que les hommes, pris en masse, jouent toujours le jeu de quelqu’un d’autre… jamais le leur. » Dans ces 17 minutes de malstrom, il est presque impossible d’identifier l’origine des images – et c’est peut-être mieux ainsi. Celui qui vient de reconnaître dans le passage avec le petit garçon et sa voiture à pédales l’hôtel Overlook de The Shining va se demander l’instant d’après d’où vient l’autre passage, celui qui longe les cadavres gelés sur des rails couverts de neige. Les mouvements s’enchaînent, mais la juxtaposition est moins futile qu’elle ne paraît ; elle en appelle plutôt, comme un défi, à ne pas oublier les horreurs réelles par-delà les horreurs fictives. Et, inversement, de ne pas sous-estimer le cinéma, lorsqu’il s’agit de sonder et capter les courants invisibles d’une époque. Soudain, Jerry Lewis, en Nutty Professor torturé par sa métamorphose, semble offrir le commentaire adapté à un siècle qui s’est volontiers vu comme Dr Jekyll, mais plus volontiers encore transformé en M. Hyde. Même Jean Seberg ne parvient plus à rester l’observatrice neutre de l’univers de Godard, car son « qu’est-ce que c’est, dégueulasse ? » se retourne contre son temps. Que ce soit 1990, 1975, 1960, 1945, 1930 ou 1915, Godard trouverait le siècle passé tout simplement à vomir si n’étaient ces moments dans lesquels le visage d’un enfant ou le sourire d’une femme couvraient tout le reste. Mais tel qu’il le montre, ce ne sont que des épiphénomènes. « Est-ce que ce n’est pas le bonheur ? » – « Tout de même, tu m’avoueras que tout cela est bien triste. » – « Mais, mon cher, le bonheur n’est pas gai. »
Source texte : http://www.annexia-net.com/DVD_Godard_FourShortFilms.html
Retour vers la catégorie « Echantillonnages »
Retour vers la catégorie « La vie réelle »